Ci-dessous la chronique radio de ce jour sur IDFM. Bonne lecture.

Avril 1980 : on enterre un écrivain, plus qu’un écrivain même, un intellectuel entré dans la légende de son vivant, un homme qui a suscité toutes les haines et les passions : Jean-Paul Sartre. Parmi ceux qui se sont déplacés, parmi les dizaines de milliers de personnes, un homme d’une trentaine d’années. Même s’il apprécie peu celui qu’on enterre, il est tout de même venu, pour d’autres raisons, des raisons beaucoup plus personnelles :
« A cet instant, on ne règle plus les comptes. On ne fait pas de bilan. On est tous égaux et on a tous tort. Je ne suis pas venu pour le penseur. Je n’ai jamais compris sa philosophie, son théâtre est indigeste et ses romans, je les ai oubliés. Je suis venu pour de vieux souvenirs. La foule m’a rappelé qui il était. On ne peut pas pleurer un héros qui a soutenu les bourreaux. Je fais demi-tour. Je l’enterrerai dans un coin de ma tête ».
En rebroussant chemin depuis le cimetière du Montparnasse, Michel Marini reconnaît de loin la démarche de Pavel Cibulka, qu’il rattrape et stoppe dans la rue. Après quelques secondes d’hésitation, le vieil homme le remet. « Michel », « Le petit Michel ». Ils s’embrassent et tombent dans les bras l’un de l’autre. Ils vont au bar « le Select » où Pavel semble avoir ses habitudes. Là, ils évoquent le passé, eux qui ne se sont pas revus depuis une quinzaine d’années, le jour de l’enterrement de Sacha. Les blagues et les souvenirs remontent à la surface. En témoigne ce dialogue entre les deux hommes :
- « Raconte-moi encore une blague Pavel.
- Tu connais la différence entre un rouble et un dollar ?
J’avais déjà entendu cette vanne foireuse. Si ça se trouve, c’était lui qui me l’avait racontée quinze ans plus tôt. J’ai cherché sans trouver.
- Non, je ne vois pas.
- Un dollar !
Il a éclaté de rire, ravi.
- Que s’est-il passé, Michel ? On a eu de tes nouvelles pendant un moment et tu as disparu.
- Après la mort de Sacha, j’ai continué à voir Igor et Werner. Les autres, tu les revois ?
- Il n’y a que toi qu’on ne voit plus. »
Alors Michel va raconter, se replonger dans le passé, son passé, leur passé commun, là où tout a commencé, en octobre 1959.
Michel a une histoire familiale peu banale, pour l’époque au moins. Il est l’enfant d’un mariage mixte, mais pas au sens où vous l’entendez aujourd’hui, non. Un mariage mixte, en 1959, est un mariage entre personnes issues de milieux sociaux différents. A cette époque, chacun devait rester à sa place : les torchons avec les torchons, les serviettes avec les serviettes. Michel lui, est à la croisée de deux familles que tout oppose : d’une part, du côté de son père, les Marini, une ascendance d’immigrés italiens ayant fui la misère de leur pays et, d’autre part, du côté de sa mère, les Delaunay, une lignée, presque une dynastie de commerçants bourgeois. Pour fêter ses douze ans, Michel s’est mis en tête de réunir tout le monde : les Marini et les Delaunay. Cependant, même s’ils sont tous réunis, Michel observe, incrédule, deux mondes qui s’affrontent, se méprisent même. Ce que Michel ignore encore à cet instant, c’est que ce mariage mixte n’aurait certainement jamais eu lieu si son père, ouvrier de son grand-père maternel, n’avait réussi à séduire sa mère qui s’était retrouvée enceinte au début de la seconde guerre mondiale. Cette grossesse, elle l’a cachée à tout le monde pendant six mois alors que son père s’était retrouvé dans un stalag après la débâcle des Ardennes. Après quatre ans de captivité, il avait bien fallu régulariser la situation et se marier, un mariage contre nature, mais un mariage imposé, question d’honneur. Voilà l’histoire de Franck, le frère aîné de Michel, un frère sans lequel il n’aurait pas vu le jour, tout simplement parce que l’aventure de ses parents se serait heurtée à la pression sociale.
Michel vient de fêter ses douze ans et le lycée ne l’intéresse pas, exception faîte du français. Il faut dire que Michel est un lecteur compulsif qui dévore tous les livres qu’il déniche à la bibliothèque, allant même jusqu’à lire en marchant sur le chemin de l’école, quitte à parfois arriver en retard. Si Michel déteste le lycée Henri IV, c’est surtout à cause des maths auxquels il ne comprend rien de rien, comme s’il devait déchiffrer d’incompréhensibles hiéroglyphes. Heureusement, son meilleur copain c’est Nicolas, le premier de la classe, un fortiche de première en algèbre et en géométrie mais qui déteste apprendre ses leçons de français, d’histoire ou de géographie, les seules matières où Michel excelle. Les deux amis sont donc parfaitement complémentaires. Complémentaires, ils le sont aussi au baby foot, où ils forment l’une des meilleures équipes du coin, hantant les bars des environs et plus particulièrement « le Balto » comme le raconte Michel :
« Quand on se sentait en forme, prêts à bouffer la terre entière et à se faire étriller, on allait au grand bistrot de la place Denfert-Rochereau. Au Balto, il y avait deux baby. Nous, on jouait avec les grands et on nous respectait. Il ne nous serait pas venu à l’idée de jouer sur le baby à côté des flippers, même s’il était libre ou quand des joueurs nous proposaient une partie. On gardait toute notre énergie pour affronter les cadors, ceux qui venaient de la banlieue sud. »
Le Balto, c’est un bistrot d’auvergnats, tenu par la famille Marcusot, originaire du Cantal. Les Marcusot, comme de bien entendu, travaillent en famille et ne ménagent pas leur peine, travaillant sept jours sur sept de 6 heures à minuit. Mais il y a quelque chose de plus dans ce bar que décrit Michel :
« Le Balto était un immense bistrot à l’angle de deux boulevards. Sur l’avenue Denfert-Rochereau, côté comptoir et tabac, il y avait les baby, les flippers et le juke-box, et côté Raspail, un restaurant de soixante places. Entre les dernières tables, j’avais remarqué une porte derrière un rideau de velours vert. Des hommes d’âge mûr disparaissaient par ce passage. Je ne voyais personne en ressortir. Ça m’intriguait. Je me demandais souvent ce qu’il pouvait y avoir là. »
Quelques semaines plus tard, au début d’un été ensoleillé, Michel est intrigué par la présence d’un homme mal rasé avec un imperméable élimé et taché, qui disparaît derrière la tenture. Il profite d’un moment d’inattention du fils Marcusot, Jacky,
qui vient d’en sortir avec des tasses et des verres vides sur son plateau, pour se glisser derrière ce rideau qui l’intrigue tant. Ecoutez comment il décrit cet instant décisif :
« Mû par la curiosité, j’ai écarté le rideau. Une main malhabile avait inscrit sur la porte « Club des incorrigibles optimistes ». Le cœur battant, j’ai avancé avec précaution. J’ai eu la plus grande surprise de ma vie. J’ai pénétré dans un club d’échecs. Une dizaine d’hommes jouaient, absorbés. Une demi-douzaine suivaient les parties, assis ou debout. D’autres bavardaient à voix basse. Des néons éclairaient la pièce ouvrant par deux fenêtres sur le boulevard Raspail. Elle servait aussi de débarras au père Marcusot qui y rangeait des guéridons, des chaises pliantes, des parasols, des banquettes trouées et des caisses de verres. Deux hommes profitaient des fauteuils pour lire des journaux étrangers. Personne n’a remarqué mon entrée. »
Exception faite des deux illustres hommes de lettres français, dont celui qu’on a enterré au début de l’histoire, tous les autres hommes de cette assemblée sont originaires des pays de l’est, de l’autre côté du rideau de fer. Michel va s’imposer peu à peu comme un membre de ce club singulier, ce qui va lui permettre de faire leur connaissance, de découvrir leurs histoires. Avec lui, nous partagerons l’aventure d’Igor, d’Imré, de Sacha, Pavel, Léonid et tous les autres. Ils ont comme point commun d’être passés à l’ouest pour sauver leur peau, fuir un système qui s’apprêtait à les briser. Mais là n’est pas leur seul point commun, ils partagent beaucoup plus, comme nous allons le découvrir. Et puis, il y a un terrible secret que Michel ne découvrira que lors d’une tragique issue…
Ainsi donc, nous allons suivre la vie de Michel et de ces hommes durant cinq années, cinq années pendant lesquelles l’histoire familiale de Michel sera, elle aussi, totalement bouleversée, sur fond de guerre d’Algérie et de prise de pouvoir de la société de consommation.
Dans cet ouvrage fleuve de 750 pages, jamais on ne s’ennuie un seul instant, tournant les pages avec délice pour plonger la tête la première dans cet océan chahuté qui nous emmène vers des territoires insoupçonnés. Plus qu’un roman, il s’agit d’une véritable épopée, d’une chronique de la société française.
Jean-Michel Guenassia nous propose là un livre d’une ampleur et d’une ambition exceptionnelle où chaque chose est à sa place, un puzzle dont chaque pièce s’imbrique aux autres avec une remarquable justesse. Tout y est, tout ce qui fait que la vie est à la fois formidable et tragique. Ce livre est un véritable joyau. Les lycéens ne s’y sont pas trompés en lui attribuant leur Goncourt. Alors, si vous ne l’avez pas encore lu, réparez cette erreur et précipitez vous chez votre libraire pour l’acheter immédiatement.
Après avoir refermé la dernière page, je me suis déjà surpris à relire des passages entiers, comme on reprendrait une part de dessert. Je profite de cette chronique pour remercier chaleureusement Karima qui me l’a fait découvrir.





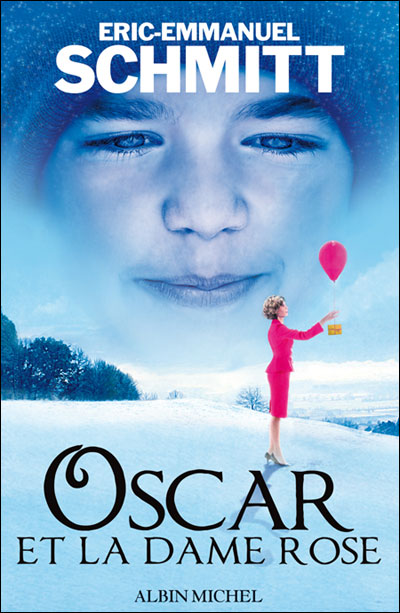

/image%2F1566958%2F20191019%2Fob_2e572a_e4ad5a6a-101a-4603-a3c3-e8209e529d71.jpeg)